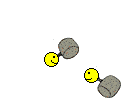Coulinette,
J'annonce tout de suite la couleur : on n'arrivera pas à tomber d'accord

.
Linette2021 a écrit :Clairement, on est d'accord sur ça... les sep probables sous Poser sont passées à SEP certaines sous McDo... donc traitées plus tôt... on n'attendait pas la deuxième poissée pour traiter ce qui faisait gagner du temps de traitement.
Comme le rappelle mon "cadeau bonux", le statut de sep "probable" était principalement laissé à l'appréciation du doigt mouillé du neurologue. Une certaine proportion des neuros pouvaient aller jusqu'à conserver le diagnostic sous le coude : pourquoi annoncer au patient une pathologie lourde pour laquelle il n'existe aucun traitement, alors qu'il y a une bonne probabilité pour que l'épisode que ce patient vient de connaître, soit le seul qu'il connaîtra de toute sa vie ? le point de vue fait mieux que se défendre... Cela provoquait de l'errance diagnostique, très fréquente à l'époque... surtout chez les femmes, errance diagnostique qui s'est réduite à peau de chagrin sous McDo.
Vaut-il mieux annoncer un diagnostic de sep à un patient qui ne connaîtra jamais plus le moindre épisode neurologique, ou vaut-il mieux le taire ? Question subsidiaire : quelle est l'utilité d'infliger un traitement qui reste relativement lourd, à un patient qui n'en tirera jamais le moindre bénéfice ?
Effectivement JP nous n'avons aucune certitude sur les futurs poussées qui peuvent être inexistantes ou fréquentes... et les deux cas de figure sont probables....
Et sont d'autant plus probables qu'on diagnostique dès le stade du SCI. En attendant la survenue d'un deuxième épisode (qui souvent ne surviendra jamais), la probabilité d'une future poussée est largement accrue et celle de ne plus jamais en connaître devient quasi-nulle. Une autre très bonne raison d'affirmer que diagnostiquer dès le SCI, comme institué par McDonald, accroît mathématiquement la proportion de personnes qui connaîtront une évolution favorable, peu importe qu'ils prennent un traitement ou pas.
et justement dans les études ce sont ces deux types de patients qu'ils comparent en étudiant l'efficacité des traitements
Ca m'étonnerait beaucoup. Les patients éligibles au traitement de fond, c'est à dire essentiellement récurrents-rémittents, et qui choisissent de ne pas prendre de traitement, sont plus rares que le loup blanc. Quand j'étais allé visiter Gout en 2018, il m'avait déclaré que j'étais
le premier patient récurrent-rémittent sans traitement qu'il rencontrait depuis au moins dix ans. Pourtant, je suppose qu'en une année il en voit défiler quelques-uns, des patients récurrents-rémittents...
Si les patients RR sans traitement cessent de fréquenter les hôpitaux qui ont une activité de recherche, soit qu'ils choisissent de se faire suivre par un neurologue de ville, par un simple généraliste ou par rien du tout, comment veux-tu qu'ils soient intégrés aux études ? Seules une toute petite minorité des études de cohorte (EDMUS en particulier, la "cohorte lyonnaise") tentent d'intégrer tout ça, au petit bonheur la chance. Ce qui signifie que pour toutes les autres, pschitt, rien.
Pour moi ils ne seront pas restés sans diagnostic, mais mis sous le chapeau de sep probable à confirmer par une deuxième poussée...ce qui dans les bases de données des recherches a une grande utilité.
Relis mon cadeau bonux

. "[Les critères de Poser] ont eu l’inconvénient de divulguer largement la catégorie “SEP probable”, concept
sans utilité pour les patients, qui ne retenaient que le mot “SEP”, ainsi que pour les neurologues, pour qui la réalité “probable” était très variable, et même pour les épidémiologistes, pour qui on l’avait conservée. Carton plein

.
Sauf que ce qu'ils comparent dans les études se sont les patients qui sont sous traitement et les patients sans aucun traitement ... [etc.]
Ca dépend profondément de quels types d'études on parle.
1. S'il s'agit d'études de cohorte (niveau de preuve moyen), ces études prennent en compte...
les patients qu'elles connaissent. Or, si un patient sous traitement sera en général connu (si son neurologue pense à mettre à jour la fiche après chaque consultation, s'entend), seuls les patients sans traitement
qui continueront à consulter régulièrement leur neurologue seront renseignés. Au bout d'un certain temps après la dernière mise à jour de leur fiche, ils ne seront plus pris en compte par les études de cohorte, du fait de la trop grande incertitude qui entourera leur cas : si ça se trouve ils sont morts, ou ils sont suivis par un nouveau neuro qui ne s'enquiquine pas à mettre les fiches à jour, ou ils ont tout simplement arrêtés d'être suivis, etc. : comment on fait pour deviner ce qu'ils sont devenus ?
(Je te laisse réfléchir à ma question

)
... Bin on ne peut pas, à moins de passer un temps colossal à faire des recherches, façon enquête policière. Note que c'est de cette façon qu'une autre des études citée dans ton article initial, avait comparé le taux de survie du bras Ifnβ à celui du bras placebo dans la toute première étude de validation de l'Ifnβ, menée vers le milieu des années quatre-vingts ; ils y avaient passé un temps de dingue et n'avaient réussi à retrouver la trace que d'une partie de chacun des deux bras, ce qui induisait un biais de sélection évident. Cette façon de procéder, si elle est d'un meilleur niveau de preuve que l'étude de cohorte standard, reste extrêmement minoritaire, à cause de son coût exorbitant : la quasi-totalité des études de cohorte se contentent de taper dans leur base de données, peu importe qu'elle soit à jour ou pas, sachant que plus un patient a une évolution bénigne, plus grande sera la probabilité qu'il ait disparu des écrans radars. C'est notamment pour cette raison que le niveau de preuve scientifique des études de cohorte reste très perfectible, du fait d'un important risque de biais, notamment biais de sélection.
2. Si maintenant il s'agit du mètre-étalon de l'étude, à savoir la randomisée double-aveugle (remarque :
aucune des études citées dans ton article initial ne fait partie de cette catégorie, ce sont toutes ou presque des études de cohorte, la seule exception éventuelle étant celle qui a démontré la supériorité du natalizumab sur l'interféron-bêta, d'un niveau de preuve intermédiaire entre la cohorte et la randomisée double-aveugle), pendant longtemps on a certes comparé un bras "traitement" à un bras "placebo", c'est à dire sans traitement. Sauf que, dans le cas de la sep, ça ne se fait plus depuis un bon bout de temps : sachant que des traitements relativement efficaces existent, il serait moralement inacceptable d'infliger de la poudre de perlimpinpin à un des bras de l'étude ; dans les études actuelles, les candidats-traitements sont donc, en règle très générale, comparés à un bras Ifnβ. Ca fait un moment que le "sans traitement", ou placebo si tu préfères, a cessé d'exister dans ces études.
Nostromo a écrit :Si je t'ai mise de côté, c'est parce que l'augmentation de l'espérance de vie sans handicap que l'on constate avec les cas de Caribette et de Maglight, est parfaitement indépendante de la prise d'un quelconque traitement : cette tendance existe, tu la constates, et elle ne peut en aucun cas être mise au crédit des traitements de fond.
Tu sais parfaitement JP qu'on ne peut généraliser à partir de deux cas...
Mon petit doigt me souffle que tu considères qu'il y a bien plus que deux cas, ce qui autorise la généralisation : "
comme tu le sais JP beaucoup de patients refusent le traitement lorsque leur sep est peu agressive leur permettant de bien récupérer...". Donc comme je disais, cette tendance existe,
tu la constates, et elle ne peut en aucun cas être mise au crédit des traitements de fond

.
et que des sep bénignes existent (10% selon la littérature)
On a déjà eu cette discussion, la littérature en question se base sur des données qui remontent à Poser. Depuis Poser, la prévalence de la sep a été multipliée par deux voire trois, et le sex-ratio F:H qui était de 3:2 à la fin des années 1990, est passé à 3:1 aujourd'hui. Plus fascinant encore, si on approfondit ces chiffres, cette
épidémie n'a touché
que les femmes : le risque pour un homme n'a pour ainsi dire pas bougé depuis la fin des années 90, alors que le risque des femmes a explosé.
et selon cette même littérature ces sep peuvent évoluer, parfois après des dizaines d'années de silence en sep parfois agressives (ce que je ne souhaite à personne)... d'ailleurs dans la littérature ils ne parlent de sep bénigne qu'après au moins 15 ans d'évolution en restant très prudent
La littérature en question se base sur des données qui remontent à Poser, c'est à dire à une époque où on ne diagnostiquait les sep latentes qu'à l'autopsie, pas avant -- observation dont rien ne permet d'exclure qu'elle ne soit pas la raison première de l'évolution considérable à la fois de la prévalence et du sex-ratio, depuis McDonald. Que sont, aujourd'hui, devenues les sep latentes ?
Pour moi les critères de McDo ont simplement permis aux patients d'être traités plus tôt... donc de limiter de 30% l'apparition de nouvelles lésions qui peuvent être silencieuses dans un premier temps ... et faire la fête en continue pas la suite....
Que sont devenues les sep latentes ? Comment expliquer que la prévalence de la sep ait été multipliée par deux à trois depuis McDo ? As-tu une raison pour exclure l'hypothèse selon laquelle on diagnostique en tant que sep à part entières, des formes qui, traitement ou pas, resteront de toute façon latentes pendant toute la vie du patient ?
encore une fois les recherches sur l'efficacité des traitement comparent l'évolution des patients avec sep confirmés, deux groupes, ceux qui prennent des traitements et ceux qui n'en prennent pas... mais pas les patients avec une sep probables.
J'ai déjà répondu à ça, le bras sans traitement a disparu des études depuis un bon bout de temps.
D'un point de vue scientifique, quand on souhaite mesurer l'impact d'un facteur quelconque, quelle que soit ce facteur, on se doit de le mesurer "toutes choses égales par ailleurs", on se doit en particulier de supprimer tout
facteur de confusion. Ici, décréter que l'augmentation de l'espérance de vie sans handicap (l'impact) est le résultat des seuls traitements de fond (le facteur), ignore l'existence du facteur de confusion qu'est l'évolution des critères diagnostiques dans la même période. De la même façon, décréter que l'impact serait le résultat de l'évolution des critères diagnostiques, ignorerait l'existence du facteur de confusion représenté par l'introduction des traitements.
JP tu crois vraiment que des revues scientifiques faisant autorité doit les rédacteurs en chef sont les plus grands experts de ce monde vont s'amuser à publier des recherches avec une validité interne et externe fragiles?


C'est une vraie question ? Bin, heu... oui, évidemment ! Il est très courant que deux études distinctes sur un même sujet, tombent sur des conclusions radicalement opposées.
vont faire passer des recherches dont les conclusions sont hâtives et les effets aléatoires non controlés?
Tiens, je parlais de l'évolution de la prévalence depuis McDo, évolution qui se faisait essentiellement au détriment des femmes puisque la prévalence de la sep chez les hommes restait stationnaire. Un sacré sujet d'étude ! Selon une étude très sérieuse, publiée dans le Multiple Sclerosis Journal (Sage), cette évolution est causée par un déficit en vitamine D. Uniquement chez les femmes, forcément, les hommes étant épargnés. L'étude étant iranienne, elle mentionnait la généralisation du port de la burka pour les femmes parmi les causes probables.
Bon, ça n'expliquait pas pourquoi la même évolution était constatée un peu partout dans le monde, même dans les pays où le port de la burka était plutôt rare, mais leur cohorte n'était qu'Iranienne.
Quelle validité donner à une telle étude ? Le Multiple Sclerosis Journal, c'est pourtant un journal très sérieux, hein...
Cet amateurisme n'a pas sa place dans la recherche scientifique.

. Heu... Non, rien

.
ils ne comparent pas les sep avant McDo et les sep après McDo... mais l'effet du traitement avant McDO et l'effet du traitement après McDO...
Traitement avant McDo : corticoïdes, plus une pincée d'Ifnβ et de Copaxone sur la toute fin de la période. Remarque : alors qu'il m'avait diagnostiqué en décembre 1995 à la suite d'une poussée carabinée, Gout n'avait pas voulu me mettre sous Ifnβ, "c'est encore expérimental". Après recherche, la première AMM du Betaferon remontait... au mois précédent. Gout m'a suivi de façon régulière jusqu'en 1997 (plus espacée par la suite...), à aucun moment il ne m'a reparlé de traitements : avant McDo, on ne traitait pas, ou très peu.
Traitements après McDo : tous les autres.
J'ai beau chercher, je ne vois aucune raison pour laquelle l'effet des traitements avant McDo serait différent de l'effet des traitements après McDo, si ce n'est le seul fait que McDo accélère la mise en route du traitement. L'évolution de l'offre survenue à ce moment ne saurait en aucun cas être envisagée comme un potentiel facteur confondant. Mystère, donc

!
Bizzzzz !
JP.