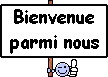Salut Eloïse, bienvenue !
Hello_élo a écrit :Par contre je me sens un peu seule dans ce choix car j'ai l'impression que peu de personne sont sans traitement...
Si ça peut t'aider à te sentir moins seule, de mon côté je n'ai pas de traitement non plus, n'en ai jamais eu si ce n'est un ou deux traitements ponctuels (quelques jours, pas plus), sep déclarée il y a 25 ans bien tassés, diagnostic deux ans plus tard. C'était la grande époque du lancement des interférons-bêta, d'ailleurs mon neuro en avait évoqué l'existence avec moi dès mes premiers instants dans la maladie. L'ordre des choses a voulu que je ne bascule jamais vers un traitement de fond.
Hier Bashogun a publié un lien vers une vidéo du Figaro, une interview du Pr. Catherine Lubetzki (bigboss de la neurologie à la Salpêtrière).
http://players.brightcove.net/610043537 ... 4607976001. Très intéressante vidéo, je la recommande vivement, on sent un discours longuement travaillé, rôdé, mûri, dans lequel chaque mot est soigneusement pesé... Dans cette interview, le Pr. Lubetzki rend un hommage appuyé à un ex-collègue lyonnais, un certain Christian Confavreux, décédé trop tôt voici quelques années. N'ayant jamais entendu parler de lui jusqu'à cette interview de Lubetzki, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur cet article passionnant :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2008 ... se-plaques. Je cite : "la vitesse d'accumulation globale du handicap n'est pas influencée par la présence ou l'absence de poussées" ; "Les interférons bêta (...) sont sans effet sur l'évolution des malades".
En tant qu' "ancien combattant" de la maladie, tout cela non seulement correspond assez fidèlement à l'image intuitive que j'en avais, mais en plus me conduit à la conclusion diffuse qu'il n'y a guère eu d'avancée thérapeutique significative depuis... la nuit des temps. Il y a eu des avancées statistiques, il y a surtout eu des avancées majeures dans le domaine de l'imagerie, mais en comparaison les avancées thérapeutiques font bien pâle figure... Pour en revenir aux propos du Pr. Lubetzki, à l'exception de ce qu'elle dit de l'efficacité des traitements (mais propos très largement remis en cause par ceux de Confavreux donc) et sur l'état actuel de la recherche (mais à un instant donné, il y a forcément toujours de nouvelles recherches en cours, et parmi celles-ci il y en a toujours quelques-unes qui sont jugées "prometteuses" ; je te garantis que c'était déjà le cas il y a vingt-cinq ans, et que c'était déjà le cas vingt-cinq ans plus tôt, etc.), il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à ce que j'avais lu dans la littérature spécialisée lorsque j'avais été diagnostiqué, en 1995 donc. Ah si, la nouveauté c'est qu'on est graduellement passé d'un ratio H/F de 2:3 (deux hommes atteints pour trois femmes, soit 40% d'hommes et 60% de femmes) à un ratio de 1:3, soit 25% d'hommes pour 75% de femmes : la connaissance statistique s'affine, c'est toujours bon à prendre, mais on n'a jamais guéri qui que ce soit à coups de statistiques. Pour le reste et pour ne donner qu'un seul exemple, même la fameuse étude de Confavreux, citée par Lubetzki dans son interview, sur l'influence de la grossesse sur la probabilité de survenue d'une poussée (probabilité diminuée pendant la grossesse, augmentée dans le post partum), était déjà un élément de connaissance largement répandu dans les publications disponibles en 1995, qui n'étaient pourtant pas imprimées de la veille. Cette étude de Confavreux aura surtout eu l'intérêt de transformer une connaissance empirique, en connaissance démontrée.
Le plus ancien, et le plus commun, des traitements, est sans doute le solumedrol (corticoïde, anti-inflammatoire puissant) qu'on administre en général par intraveineuse à forte dose pendant une durée limitée (3 jours à 1000 mg pour certains, 5 jours à 500 mg pour d'autres, etc. ; on parle de "bolus"), pour accélérer la rémission des symptômes d'une poussée en cours. Ca, j'en ai pris, une fois. On savait déjà, quand j'ai été diagnostiqué, que si la prise de bolus de solumedrol était bien utile pour se débarrasser plus rapidement des nouveaux symptômes éprouvés lors de la poussée, les éventuels symptômes résiduels à l'issue de la poussée seraient identiques, avec ou sans la prise de bolus (connaissance statistique) et que d'autre part, le pronostic à long terme de la maladie n'en serait en rien modifié. Autrement dit, comme traitement de fond, ça ne valait pas tripette, mais c'était bien confortable tout de même en cas de poussée car ça en accélérait la rémission, fût-elle partielle.
Les traitements plus récents, apparus donc depuis le milieu des années 1990 et par la suite seraient donc, d'après l'étude de Confavreux, dans une situation assez comparable -- ce qui au fond n'a rien d'étonnant quand on sait que leur mode de fonctionnement est, à l'instar du Solumedrol, avant tout anti-inflammatoire : la différence est que le Solumedrol combat une inflammation déclarée alors que les traitements de fond ont pour objet de réduire la probabilité d'inflammation. Les traitements de fond actuels n'influence(raie)nt en rien le pronostic à long terme, mais sont tout de même fort confortables en ce sens qu'ils augmentent l'intervalle entre deux poussées et qu'ils en atténueraient même la force. Autrement dit, dans le cas le plus fréquent de sep (récurrente - rémittente qui bascule par la suite en secondairement progressive), le patient est es moins dérangé pendant la première phase de la maladie (elle dure en moyenne une petite vingtaine d'années, ce qui est donc déjà pas mal), mais ça ne change rien à l'arrivée de la deuxième phase, ni à la façon -- rigoureusement impossible à prédire de façon certaine pour un patient donné -- dont elle va évoluer.
Mise en garde : à la différence des paragraphes précédents qui s'efforçaient de rester à chaque instant purement factuels, celui qui vient est le fruit d'une interprétation toute personnelle, et donc à ne pas avaler de la même façon... Cela fait bientôt dix ans que j'ai placé quelques économies en actions d'un gros labo pharmaceutique dont je tairai le nom, quand je découvre émerveillé chaque année tout ce qu'elles me crachent en dividendes, plus de dix fois le rendement d'un livret A, cela me rappelle de la meilleure des façons que tout ceci est
aussi un business. Et mieux que ça : un business dont le prescripteur (le neurologue) est globalement impuissant, pour les raisons exposées ci-dessus, à apporter quelque amélioration que ce soit au pronostic à long terme de son patient. Ce qui le met en position de faiblesse : je sais que la notion n'a rien d'intuitif pour beaucoup de patients

, et pourtant il reste que le neurologue est avant tout un être humain, avec par conséquent ses doutes et ses faiblesses. J'irai même jusqu'à dire que la vision de la détresse de ses patients lui est insupportable, en particulier du fait qu'il
sait qu'il ne dispose d'aucun moyen pour en influencer le pronostic. Et quand tu es en position de faiblesse, toutes les solutions sont bonnes à prendre... Le modèle économique du traitement de fond de la sclérose en plaques, vu par un actionnaire

.
Je me sens obligé de terminer par une lueur d'espoir, que je crois voir luire derrière cette évolution de la ventilation hommes / femmes des personnes atteintes de sep, sur les vingt-cinq dernières années, de 2:3 à 1:3. Que cela soit le résultat de l'évolution de la ventilation réelle dans la population est une hypothèse, mais pas forcément la plus vraisemblable. Je suis enclin à y voir plutôt le résultat d'une meilleure capacité de diagnostic, notamment via la généralisation de l'IRM, qui fait qu'on diagnostique aujourd'hui des cas qui passaient à travers les mailles du filet il y a vingt-cinq ans. Ces cas qui passaient à travers les mailles du filet il y a vingt-cinq ans, mais plus aujourd'hui, sont alors essentiellement de sexe féminin (avec le temps, j'ai cru comprendre qu'un neuro était plus prompt à dire à une femme qu'à un homme que c'était "tout dans sa tête"...), et tout ceci me semble être de loin la meilleure explication possible à l'augmentation récente de la part des femmes parmi les patients.
Pourquoi vois-je là dedans une lueur d'espoir ? Bah tout simplement parce que toutes ces femmes qui n'étaient jamais diagnostiquées il y a vingt cinq ans, ne l'étaient donc pas lors du déclenchement de leur maladie, disons donc autour de leurs 25 - 30 ans pour le gros des troupes,
et ne l'étaient forcément toujours pas à la fin de leur vie : sinon on les aurait intégrées, certes tardivement mais qu'importe, aux statistiques, et la ventilation H/F en aurait été immédiatement corrigée. Il est très tentant d'en conclure que toutes ces personnes ne pouvaient dans ces conditions que présenter une forme très peu active de la maladie, très peu invalidante, bénigne quoi (d'ailleurs, le sexe féminin est considéré comme un facteur prédictif favorable pour une évolution bénigne), sinon depuis le temps on les aurait tout de même diagnostiquées. Or tous ces "nouveaux" cas sont forcément nombreux, puisqu'ils ont réussi à faire évoluer dans une telle proportion la ventilation H/F. Et s'ils ont réussi à faire évoluer ce ratio, il me semble qu'ils devraient faire évoluer encore plus ("effet levier") le ratio des sep dites bénignes. En 1995 on estimait à 15% le pourcentage de sep dites bénignes, aujourd'hui je ne sais pas à combien on en est, mais si demain que ce ratio était ré-évalué à 30 voire 40 ou même 50%, je n'en serais pas particulièrement surpris. Si je regarde mon cas particulier, j'ai certes clairement identifié plusieurs poussées, seulement une seule a été d'une intensité telle, très nettement supérieure à toutes les autres, qu'elle justifie que je m'en inquiète. Et c'est donc celle-ci qui a donné lieu à mon diagnostic. J'en avais fait d'autres avant, j'en ai fait d'autres par la suite, et je suis à peu près certain que sans cette "grande poussée du diagnostic", aujourd'hui je ne serais toujours pas diagnostiqué.
Bref, je pense qu'il vaut mieux être diagnostiqué aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle, c'est de meilleur pronostic

.
A bientôt,
Jean-Philippe.